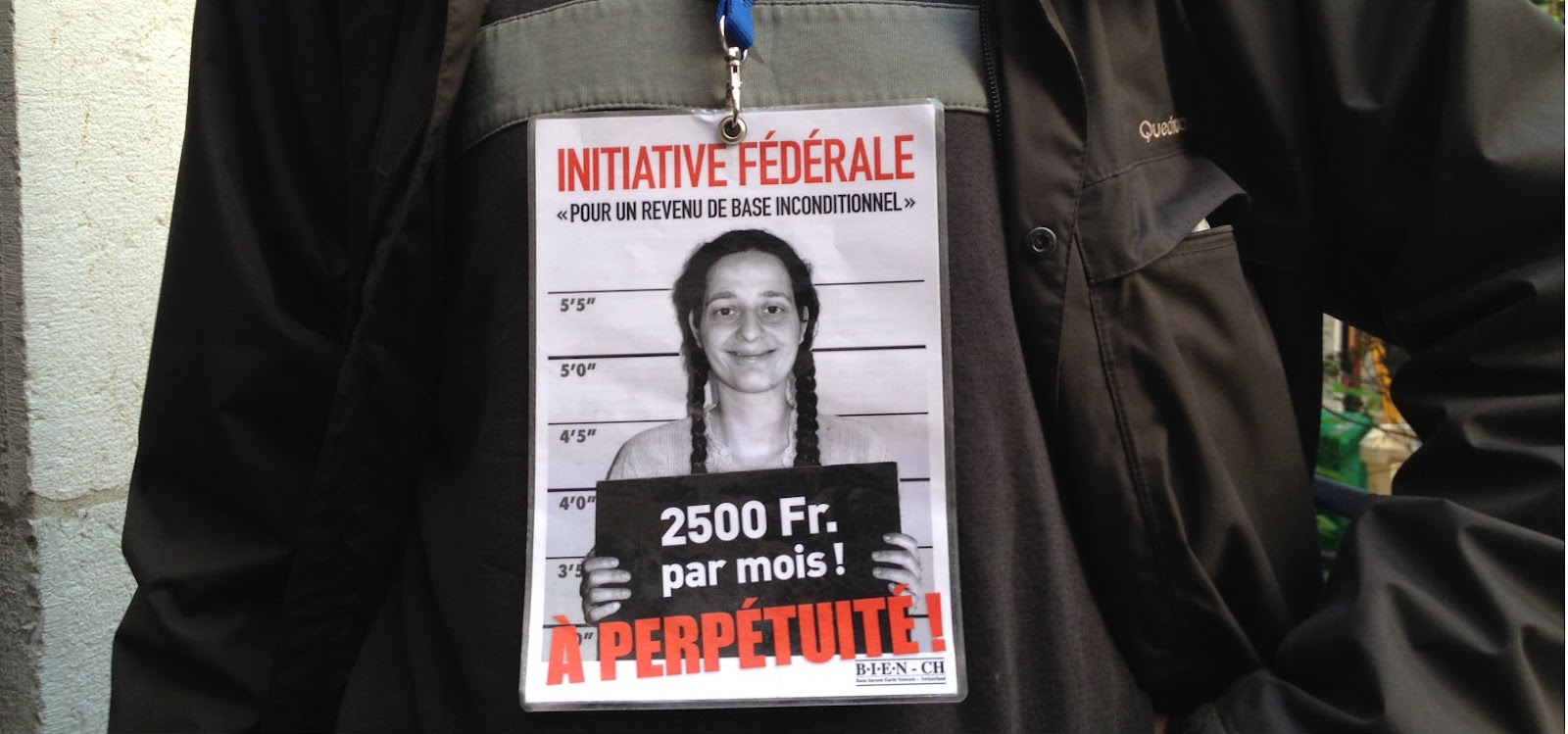
Journée mondiale de la paix 2012
par Francois de Siebenthal | Sep 21, 2012 | Uncategorized
2’500 US $ à chacun, pour la paix sociale et mondiale, partout, pour tous. La Suisse montre l’exemple. Suisse: Le premier pays du monde avec un dividende ? d | f | i Listes de signatures, but: 120’000 Téléchargement des listes de...Articles récents
Archives
- mai 2021
- août 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- avril 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- janvier 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- août 2018
- juillet 2018
- juin 2018
- mai 2018
- avril 2018
- mars 2018
- février 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- août 2017
- juillet 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- août 2016
- juillet 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- mars 2016
- février 2016
- janvier 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015
- juin 2015
- mai 2015
- avril 2015
- mars 2015
- février 2015
- janvier 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- octobre 2014
- septembre 2014
- août 2014
- juillet 2014
- juin 2014
- mai 2014
- avril 2014
- mars 2014
- février 2014
- janvier 2014
- décembre 2013
- novembre 2013
- octobre 2013
- septembre 2013
- août 2013
- juillet 2013
- juin 2013
- mai 2013
- avril 2013
- mars 2013
- février 2013
- janvier 2013
- décembre 2012
- novembre 2012
- octobre 2012
- septembre 2012
- août 2012
- juillet 2012
- juin 2012
- mai 2012
- avril 2012
- mars 2012
- février 2012
- janvier 2012
- décembre 2011
- novembre 2011
- octobre 2011
- septembre 2011
- août 2011
- juin 2011
- mai 2011
- avril 2011
- mars 2011
- février 2011
- janvier 2011
- décembre 2010
- novembre 2010
- octobre 2010
- septembre 2010
- août 2010
- juillet 2010
- juin 2010
- mai 2010
- avril 2010
- mars 2010
- février 2010
- janvier 2010
- décembre 2009
- novembre 2009
- octobre 2009
- septembre 2009
- août 2009
- juillet 2009
- juin 2009
- mai 2009
- avril 2009
- mars 2009
- février 2009
- janvier 2009
- décembre 2008
- novembre 2008
- octobre 2008
- septembre 2008
- août 2008
- juillet 2008
- juin 2008
- mai 2008
- avril 2008
- mars 2008
- février 2008
Catégories
Pages
- 5G ?
- Accueil
- Activités du site
- Agenda
- Bientôt.
- Cantons
- Contact
- Démocratie directe
- Fraudes
- Gilets jaunes en Suisse
- Groupes
- Invitations
- L’or suisse volé par le FMI et la FED, votez oui pour résister.
- Les chiffres
- Listes
- Logo
- Membres
- Nature.
- Nos actions récentes
- Petition
- Presse
- Résumé:
- Services
- SpiritualitéS
- Vidéos
Indésirable bloqué
Archives
- mai 2021
- août 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- avril 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- janvier 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- août 2018
- juillet 2018
- juin 2018
- mai 2018
- avril 2018
- mars 2018
- février 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- août 2017
- juillet 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- août 2016
- juillet 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- mars 2016
- février 2016
- janvier 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015
- juin 2015
- mai 2015
- avril 2015
- mars 2015
- février 2015
- janvier 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- octobre 2014
- septembre 2014
- août 2014
- juillet 2014
- juin 2014
- mai 2014
- avril 2014
- mars 2014
- février 2014
- janvier 2014
- décembre 2013
- novembre 2013
- octobre 2013
- septembre 2013
- août 2013
- juillet 2013
- juin 2013
- mai 2013
- avril 2013
- mars 2013
- février 2013
- janvier 2013
- décembre 2012
- novembre 2012
- octobre 2012
- septembre 2012
- août 2012
- juillet 2012
- juin 2012
- mai 2012
- avril 2012
- mars 2012
- février 2012
- janvier 2012
- décembre 2011
- novembre 2011
- octobre 2011
- septembre 2011
- août 2011
- juin 2011
- mai 2011
- avril 2011
- mars 2011
- février 2011
- janvier 2011
- décembre 2010
- novembre 2010
- octobre 2010
- septembre 2010
- août 2010
- juillet 2010
- juin 2010
- mai 2010
- avril 2010
- mars 2010
- février 2010
- janvier 2010
- décembre 2009
- novembre 2009
- octobre 2009
- septembre 2009
- août 2009
- juillet 2009
- juin 2009
- mai 2009
- avril 2009
- mars 2009
- février 2009
- janvier 2009
- décembre 2008
- novembre 2008
- octobre 2008
- septembre 2008
- août 2008
- juillet 2008
- juin 2008
- mai 2008
- avril 2008
- mars 2008
- février 2008
Commentaires récents
- Q SCOOP – François de Siebenthal explique comment on truque les votes et les élections en Suisse. – L'Informateur. dans Fraudes électorales conséquentes en Suisse
- François de Siebenthal dans Révision totale de la constitution suisse
- avreb dans Non-réélection d’Isabelle BIERI
- Martouf dans Serment 2020
- shravaka francois dans Référendum contre la loi coronavirus
Pages
- 5G ?
- Accueil
- Activités du site
- Agenda
- Bientôt.
- Cantons
- Contact
- Démocratie directe
- Fraudes
- Gilets jaunes en Suisse
- Groupes
- Invitations
- L’or suisse volé par le FMI et la FED, votez oui pour résister.
- Les chiffres
- Listes
- Logo
- Membres
- Nature.
- Nos actions récentes
- Petition
- Presse
- Résumé:
- Services
- SpiritualitéS
- Vidéos
Chercher dans les Forums
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Statistiques des Forums
- Comptes enregistrés
- 14
- Forums
- 1
- Sujets
- 10
- Réponses
- 3
- Mot-clés du sujet
- 12
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Chercher dans les Forums
Statistiques des Forums
- Comptes enregistrés
- 14
- Forums
- 1
- Sujets
- 10
- Réponses
- 3
- Mot-clés du sujet
- 12
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Étiquettes
Chercher dans les Forums
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Articles récents
Sujets récents
- Closed Captioning Services For Movie Videos
- Everyone Wants Interview Transcription Services
- Focusing On The Major Aspects of Book Translation Services
- Everything You Need To Know About Marriage Certificate Translation
- Know The Essential Things That You Get From professional Spanish Subtitling And Other Such Subtitling Services
Groupes
-
Actif il y a 4 ans et 7 mois
-
Actif il y a 4 ans et 7 mois
-
Actif il y a 4 ans et 7 mois
Membres
-
Actif il y a 2 mois
-
Actif il y a 3 ans et 1 mois
-
Actif il y a 4 ans et 1 mois
-
Actif il y a 4 ans et 2 mois
-
Actif il y a 4 ans et 3 mois
Archives
- mai 2021
- août 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- avril 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- janvier 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- août 2018
- juillet 2018
- juin 2018
- mai 2018
- avril 2018
- mars 2018
- février 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- août 2017
- juillet 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- août 2016
- juillet 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- mars 2016
- février 2016
- janvier 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015
- juin 2015
- mai 2015
- avril 2015
- mars 2015
- février 2015
- janvier 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- octobre 2014
- septembre 2014
- août 2014
- juillet 2014
- juin 2014
- mai 2014
- avril 2014
- mars 2014
- février 2014
- janvier 2014
- décembre 2013
- novembre 2013
- octobre 2013
- septembre 2013
- août 2013
- juillet 2013
- juin 2013
- mai 2013
- avril 2013
- mars 2013
- février 2013
- janvier 2013
- décembre 2012
- novembre 2012
- octobre 2012
- septembre 2012
- août 2012
- juillet 2012
- juin 2012
- mai 2012
- avril 2012
- mars 2012
- février 2012
- janvier 2012
- décembre 2011
- novembre 2011
- octobre 2011
- septembre 2011
- août 2011
- juin 2011
- mai 2011
- avril 2011
- mars 2011
- février 2011
- janvier 2011
- décembre 2010
- novembre 2010
- octobre 2010
- septembre 2010
- août 2010
- juillet 2010
- juin 2010
- mai 2010
- avril 2010
- mars 2010
- février 2010
- janvier 2010
- décembre 2009
- novembre 2009
- octobre 2009
- septembre 2009
- août 2009
- juillet 2009
- juin 2009
- mai 2009
- avril 2009
- mars 2009
- février 2009
- janvier 2009
- décembre 2008
- novembre 2008
- octobre 2008
- septembre 2008
- août 2008
- juillet 2008
- juin 2008
- mai 2008
- avril 2008
- mars 2008
- février 2008

Commentaires récents